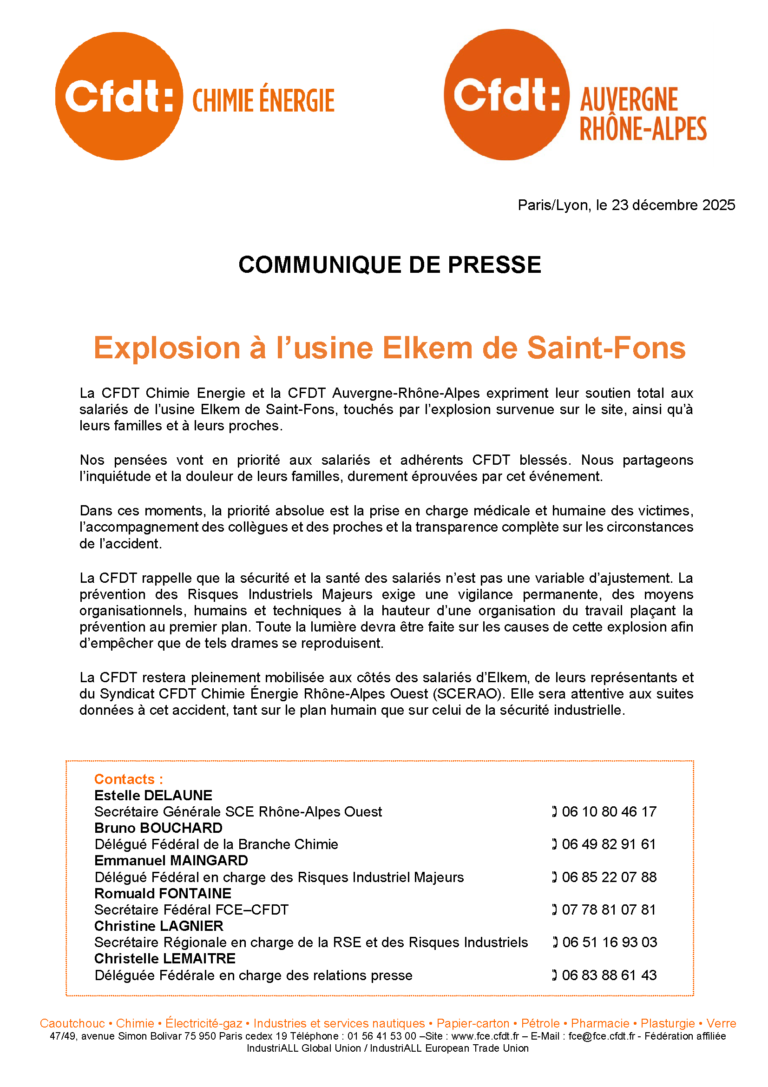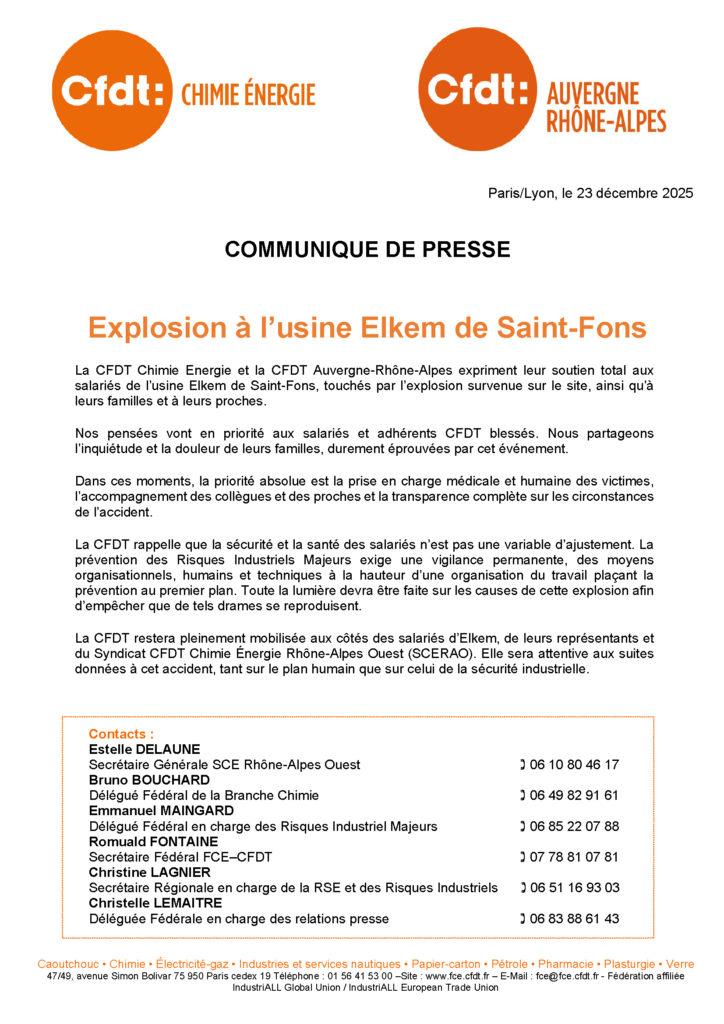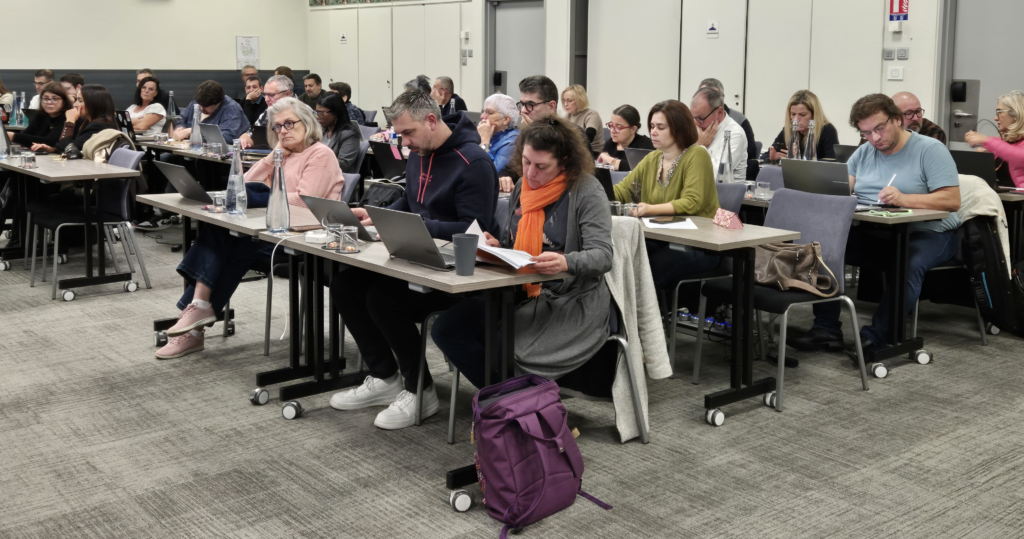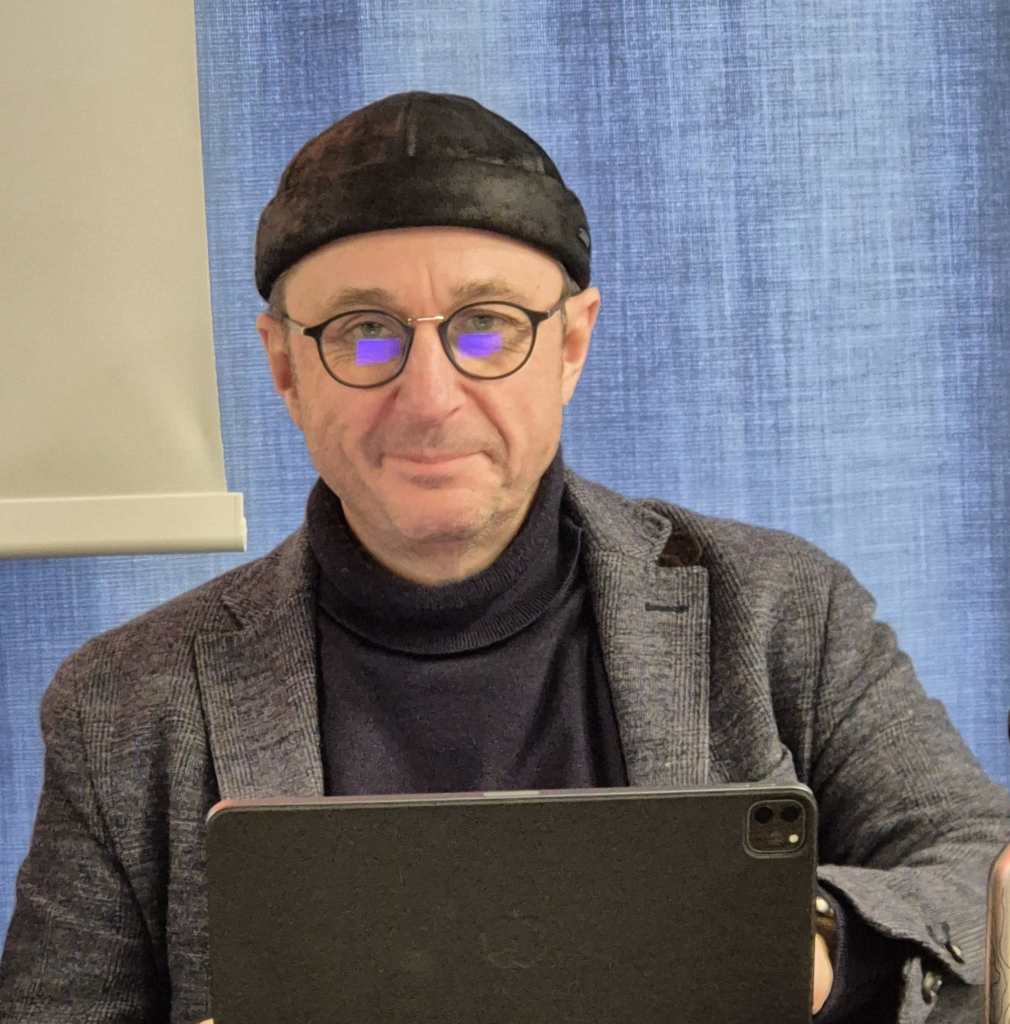La méthode de l’arbre des causes est un outil d’analyse des accidents du travail qui permet, à partir des faits réels, de développer des actions de prévention en mettant l’accent sur les facteurs potentiels d’accidents. Un outil qui permet donc de tendre vers un aménagement planifié des conditions de travail. .
La méthode d’analyse des accidents par l’arbre des causes a vu le jour il y a plus de trente ans à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). A partir de 1976, sa diffusion s’est faite dans le milieu industriel. Aujourd’hui, un grand nombre d’entreprises utilisent cette méthode comme technique d’investigation et de recherche des facteurs d’accidents.
LES PRINCIPES DE LA METHODE. Cette méthode permet d’aboutir à la fois à des actions de correction et de prévention. Suite à un accident, une enquête est menée afin de reconstituer le déroulement de l’accident. A partir des éléments recueillis, les faits sont mis en relation les uns par rapport aux autres : un arbre des causes est ainsi établi. Cet arbre permet de visualiser l’articulation des faits qui ont conduit à l’accident, et d’analyser les situations pouvant faire l’objet à la fois d’actions correctives et de mesures de protection, afin que l’accident ne se reproduise pas.
UNE METHODE EN ADEQUATION AVEC LA MISSION DES ELUS CHSCT. Dans le cadre de ses missions, le Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) est amené à réaliser des enquêtes après accident grave ou incidents répétés, ayant révélé un risque grave au travail. A cette occasion, le CHSCT peut utiliser tous les moyens à sa disposition : enquêtes, inspections, missions, expertises…
La méthode de l’arbre des causes fournit non seulement une technique qui permet d’améliorer les pratiques d’enquête post-accident, mais elle propose surtout des moyens de poursuivre l’action, notamment par la constitution de « dossiers accidents », le suivi des mesures de correction et de prévention, le repérage des facteurs potentiels d’accidents, des bilans périodiques, etc. L’ensemble de ces éléments doit venir alimenter la mission globale des élus CHSCT de « protection de la santé et de la sécurité des salariés ». Certains éléments viendront, par exemple, alimenter les inspections périodiques, le Programme d’action et de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (Papripact), le document unique, voire déclencheront une enquête particulière à l’initiative du CHSCT.
UNE METHODE BASEE SUR UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE. La méthode de l’arbre des causes s’appuie sur des principes théoriques découlant de travaux de recherche initiés par la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Ceca) sur les causes profondes d’accidents survenus dans les années 60. Elle a ensuite été expérimentée pour la première fois de façon pratique en 1970 dans les mines de fer de Lorraine.
Dans ce cadre, l’accident est abordé comme le symptôme de dysfonctionnements dans l’entreprise. L’accident apparaît comme une perturbation du cours prévu des choses. Et pour pouvoir l’expliquer, il faut disposer de l’ensemble des facteurs de la situation de travail qui a conduit à sa genèse. Il s’agit d’une conception multi-causale de l’accident, qui dépasse largement les explications courantes en termes de fatalité (« c’est la faute à pas de chance ») ou, plus grave encore, en termes d’infraction aux consignes de la part d’un salarié (« ça devait arriver avec lui, il ne respecte jamais la procédure »).
UNE METHODE SYNONYME DE GESTION DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS. Si le nombre d’accidents du travail déclarés a largement diminué ces dernières années, celui des accidents graves a augmenté. La méthode de l’arbre des causes est résolument orientée vers la recherche de mesures de prévention afin de diminuer le poids de la menace d’un accident.
La méthode repose sur une enquête qui doit permettre de disposer d’un maximum d’éléments faisant apparaître l’origine multi-causale de l’accident. De fait, les actions à entreprendre par la suite ne peuvent se limiter à une prévention dotée de solutions toutes faites. L’articulation des faits que l’arbre met en évidence montre que l’accident ou l’incident est inéluctable chaque fois que ces faits sont réunis. Il n’y a donc pas de place pour la chance.
Pour cela, la méthode doit prendre en compte les situations dans leur globalité et dépasser les explications de l’accident seulement en termes de facteurs techniques ou seulement de facteurs humains, qui limitent ensuite la nature et la portée des mesures de prévention envisageables. Seront donc analysées les informations relatives à l’opérateur (son poste, son âge, son ancienneté, les formations suivies… ), à la tâche à réaliser (existe-t-il des procédures ? ), aux outils mis à disposition, à l’environnement de travail, enfin à l’organisation du travail (horaires, rythme de travail, objectifs assignés, etc.).
L’accident du travail est le révélateur, parfois dramatique, d’un dysfonctionnement dans le processus de réalisation de la production, et survient, dans la majorité des cas, lors de tentatives de récupération d’incidents. Au cours de son enquête, le CHSCT doit donc se donner les moyens d’accéder à l’historique des dysfonctionnements d’une machine, d’une chaîne de production, etc.
UNE METHODE QUI PERMET LA RIGUEUR. La pratique de l’arbre des causes connaît malheureusement des caricatures. Mais utilisée à bon escient, elle constitue un outil structurant. Reposant sur la recherche méthodique de faits concrets, visibles, précis et vérifiables, cette méthode exclut toute interprétation a priori, et oblige les élus de CHSCT à travailler de façon rigoureuse. Ainsi, aucun arbre ne doit comporter des expressions telles que « il roulait trop vite », « il néglige toujours les règles de sécurité », « je pense qu’il devait encore être en retard » …
Cette méthode propose aussi une technique pour découvrir systématiquement les relations entre les faits en confrontation avec la réalité du travail. Dans ce cadre, elle permet de construire des revendications syndicales solides, précises et étayées dans des domaines variés.
UNE METHODE QUI FAVORISE DES PRATIQUES DE TRAVAIL COLLECTIVES. A elle seule, l’utilisation de la méthode de l’arbre des causes ne garantit pas que tous les faits auront été recueillis ni que toutes les relations entre les faits seront établies. Car, quelle que soit la volonté d’objectivité et d’exhaustivité de l’enquêteur, certaines informations peuvent demeurer inaccessibles, lui échapper, ou encore lui parvenir déformées. Chacun est empreint de son passé, de ses connaissances, de sa familiarité avec les différentes situations de travail concernées, de sa situation hiérarchique, de ses rapports avec ses collègues, etc. Dans ce contexte, des erreurs ou des omissions peuvent être faites. C’est pourquoi, un travail de groupe, où chacun s’exprime en fonction des éléments dont il dispose, permet une discussion collective et la mise en évidence à la fois des convergences, mais surtout des points de divergence devant être débattus.
Plus l’enquête post-accident est riche et précise, plus le groupe de travail peut accéder à des causes en amont de l’événement ultime. Et plus les actions entreprises seront loin de l’accident, plus elles seront efficaces. Il ne faut donc pas se limiter au seul recueil des faits.
Mais si elle permet de travailler a posteriori sur un accident, cette méthode ne peut en aucun cas être suffisante pour le CHSCT. En effet, la mobilisation la plus courante en matière de prévention est de réagir à un accident du travail. Cependant, le CHSCT doit également être en capacité de contribuer à la prévention par sa propre analyse des risques professionnels et des conditions de travail.
ATTENTION, CECI N’EST PAS UN ARBRE DES CAUSES !
La méthode de l’arbre des causes est fréquemment utilisée en entreprise, mais à des fins parfois éloignées des principes qui la guident. Ce que ne doit pas être cet outil :
• le moyen d’identifier les écarts aux normes et/ou aux règles afin de sanctionner. Dans ce cadre, l’arbre des causes est construit pour remonter jusqu’à un fait du type « non respect d’une consigne », « ne portait pas un équipement de protection individuel », etc. Ces utilisations s’inscrivent alors souvent dans des politiques de sécurité visant plus la conformité que l’aide concrète à travailler en sécurité. Malheureusement, dans ce cadre, la prévention se limite au rappel d’injonctions réglementaires. En cas d’accident, tout se focalise alors sur l’auteur de la faute, plutôt que sur la recherche du potentiel de risque d’une situation de travail.
• L’approche multi-causale d’un accident est abandonnée, et on se retrouve alors dans le schéma : 1 cause / 1 effet / 1 solution.
• le moyen de juger des compétences des opérateurs. Dans ce cadre, un modèle sous-jacent « compétences versus incompétences » sert de référentiel à la construction de l’arbre avec une forme d’évaluation, voire de jugement des compétences des opérateurs concernés.
• le moyen de repérer les comportements déviants. L’arbre est dans ce cas construit à partir des comportements, et constitué d’éléments tels que« inattention », « baisse de vigilance », « monotonie », « déviance », « il court, mais il n’a pas à le faire », etc. Cette approche peut avoir pour conséquences des avertissements, des sanctions, etc.
ne.
?
POUR EN SAVOIR PLUS
L’association Idéforce dispense un ensemble de formations destinées aux élus de CHSCT. Ces formations sont accessibles aux élus prenant un nouveau mandat (formation générale de base) ou souhaitant approfondir certaines thématiques. A la demande, Idéforce réalise des formations à la méthode de l’arbre des causes.
Pour tout renseignement, contactez votre syndicat Chimie Energie ou Aurèle Ricard au 01 56 41 53 53.